Lau_Rence
Kameskpwilliam
Elizabella
Lordedam
Cecay87
Bosquito
Sylvie9176
Magali1947
Sylviane17
Lucien Murat
Arrêtez de tondre vos putains de pelouses !
« Arrêtez de tondre vos putains de pelouses ! » n’est ni un ordre, ni une injonction, encore moins une
complainte mais bien un impératif catégorique, une action, ou une non-action individuelle qui pourrait
être élevée au rang de maxime universelle. Le réveil d’une voix douce, forte de savoirs scientifiques,
qui, s’élevant au-dessus du brouhaha des opinions, nous guiderait vers une nouvelle relation au vivant,
bénéfique et empathique, loin de tous les rapports de domination qui sont encore la norme
d’aujourd’hui.
Tondre, voilà un geste qui peut sembler anodin, une norme sociale profondément ancrée dans nos
mœurs ; il est souvent notre premier rapport avec une nature aménagée. « S’il te plaît peux-tu tondre
la pelouse ? » me demandait-on souvent lorsque j’étais jeune. Heureux de rendre service et de conduire
ce joli tracteur vert, je décrivais alors de manière concentrique de grands rectangles jusqu’à ce que la
surface verte rencontre les critères esthétiques stricts de la maison.
Mais cette action, loin d’être bénigne, pose les jalons du conditionnement culturel qui régit notre rapport
à une nature pliée à nos désirs et sur laquelle nous venons plaquer des concepts rigides. Tondre c’est
projeter une surface plane et figée sur une forme vivante, en mouvement par essence.
Tondre c’est aussi et peut-être avant tout l’idée qu’un jardin propre ne révèle toute sa beauté qu'une
fois ordonnée et rangée. Une vision hygiéniste du monde qui ne tolère ni le sale ni le négligé, et qui
pour ce faire a classé, ordonné et hiérarchisé le vivant, plaçant d’un côté les « mauvaises herbes » et
de l’autre les « bonnes », nous autorisant à arracher et éliminer tout ce qui gâcherait le tableau d’une
nature immaculée. En niant le fonctionnement même des écosystèmes, où chaque élément prend part
à l'équilibre fragile qui orchestre le génie naturel, nous en venons à nier la vie elle-même, mettant en
péril l’humanité toute entière.
Quelle est donc cette étrange époque, où les scientifiques s’égosillent à cor et à cri pour nous prévenir
du cataclysme à venir, ce point de bascule où la Terre ne sera plus viable. Qui semble écouter ces
cassandres malheureux dont les modèles prévisionnels, en réalité trop optimistes, ont sous-estimé la
rapidité et la brutalité du réchauffement climatique ?
Alors que nous faisons face aux limites physiques des écosystèmes, l’esprit humain semble pour sa
part incapable de se figurer dans toutes leurs complexités les conséquences mortifères de la
dégradation du vivant.
Dis à tes amis de se créer un compte!
 Liste des inscrits (1/5 reste 4)
Liste des inscrits (1/5 reste 4) Liste d'attente
Liste d'attente » Je m'inscris «

 Il y a 2 commentaires sur cette sortie.
Il y a 2 commentaires sur cette sortie. » Je m'inscris «











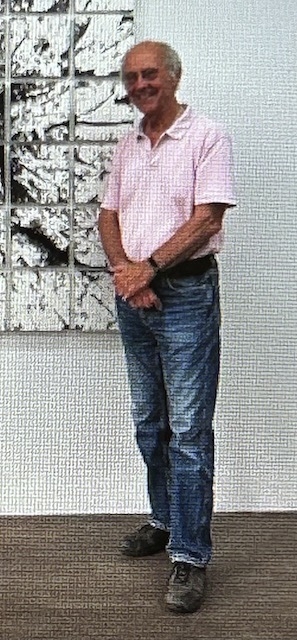

 Tête bleue
Tête bleue Bronze
Bronze Argent
Argent Or
Or Platine
Platine Titane
Titane